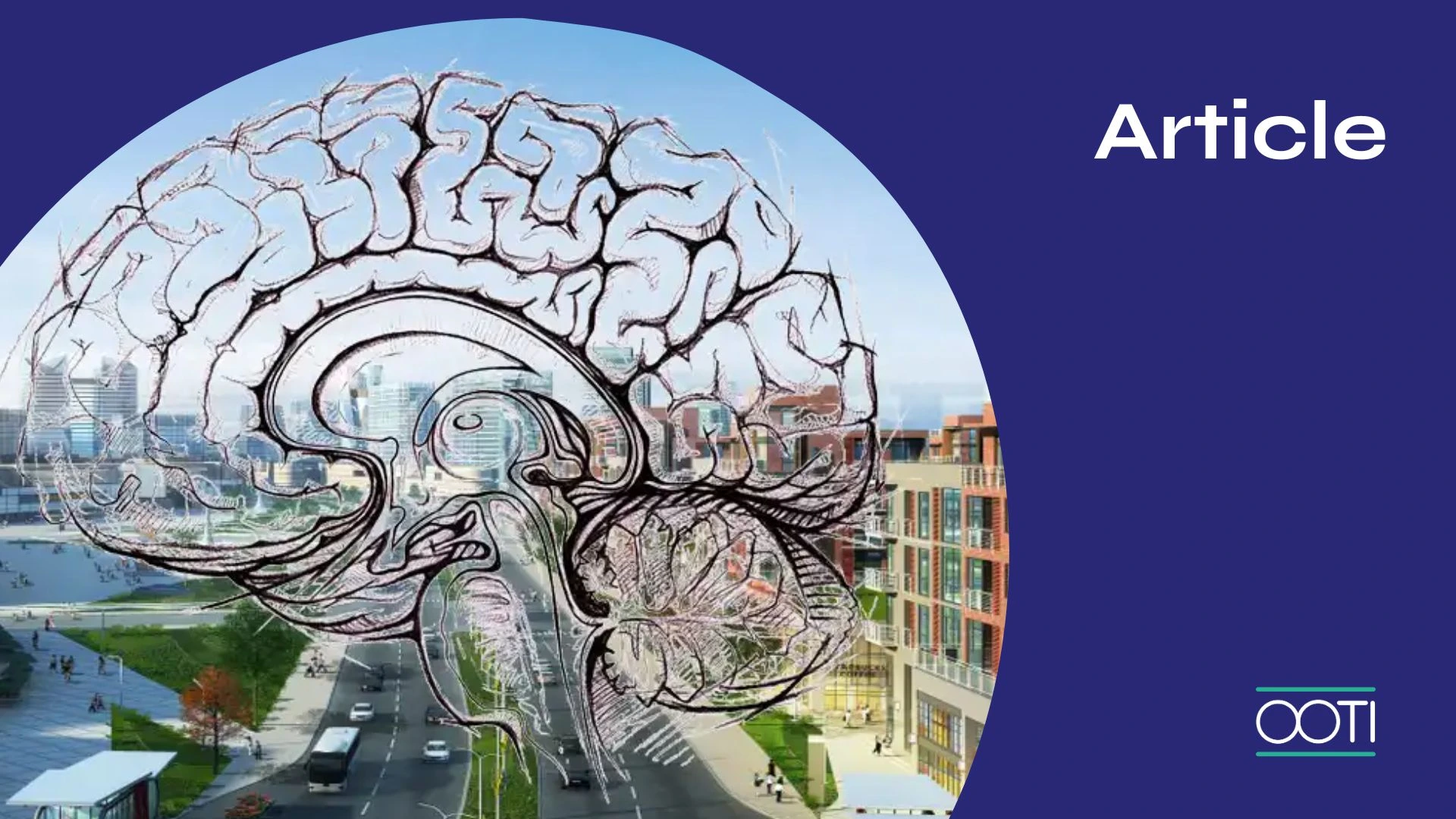
Neuroarchitecture | Quand l’architecture influence le cerveau
.png)
À l’intersection des neurosciences et de l’architecture, un domaine semble émerger pour répondre aux besoins fondamentaux de l’être humain. La neuroarchitecture, portée par les travaux du professeur Colin Ellard, relève le défi de concevoir des lieux qui influencent positivement notre cerveau. De l’aménagement des bureaux aux projets d’hôpital pour personnes autistes, cette science prend en compte les réactions des utilisateurs face aux matériaux et à l’environnement architectural. Les études menées en université démontrent l’effet significatif des espaces sur notre bien-être. OOTI revient sur ce sujet qui pourrait amener les professionnels de l’architecture et du bâtiment à améliorer leurs processus de construction.
La neuroarchitecture | Quand le cerveau redesigne nos espaces
La neuroarchitecture est une discipline qui applique les connaissances des neurosciences cognitives pour comprendre et optimiser notre interaction avec les espaces architecturaux. Elle examine de manière scientifique comment les caractéristiques des bâtiments influencent notre cerveau, nos émotions et notre comportement.
Cette approche trouve ses origines dans l’expérience de Jonas Salk, découvreur du vaccin contre la polio, qui puisa l’inspiration lors d’un séjour dans un monastère italien. Cette révélation l’amena à créer l’Académie de Neurosciences pour l’Architecture (ANFA). Plus récemment (janvier 2024), l’Espagne a accueilli son premier congrès de neuroarchitecture.
La neuroarchitecture valide scientifiquement ce que de nombreux architectes pratiquent déjà intuitivement. Comme l’affirme l’architecte Íñigo Ortiz, elle confirme par des données ce que le bon sens et la proximité avec la nature suggèrent. Au laboratoire de neuroarchitecture de l’UPV (Universitat Politècnica de València), les chercheurs utilisent des technologies objectives pour mesurer les réponses neurophysiologiques des personnes face à différents environnements.
Les principes de neuroarchitecture qui façonnent nos comportements
La neuroarchitecture repose sur des principes fondamentaux qui influencent notre façon d’interagir avec notre environnement. Ces principes, validés scientifiquement, démontrent comment l’architecture peut impacter nos émotions et nos comportements quotidiens.
Selon Elisabet Silvestre, l’intégration naturelle des bâtiments dans leur environnement est essentielle. Une architecture en harmonie avec son contexte favorise instinctivement notre bien-être. En complément, la certification WELL (qui mesure le bien-être à l’intérieur des bâtiments) souligne l’importance de l’équité et de l’inclusion dans les espaces. Comme l’affirme Giovanna Jogger, « la diversité, l’équité et l’inclusion sont des impératifs stratégiques » pour créer des environnements véritablement fonctionnels.
Les espaces verts et bleus jouent également un rôle central. Voir, sentir et entendre de façon régulière la nature améliore notre humeur et notre santé : les parcs et forêts diminuent notre niveau de stress.
Almudena Bustos, chef de projet pour la décarbonisation chez Sanitas, insiste sur la nécessité de réhumaniser les bâtiments, en particulier pour les personnes vulnérables. La renaturalisation enrichit le bien-être émotionnel des personnes aux perceptions sensorielles altérées. Les textures, les matériaux, le mobilier et l’éclairage sont d’autant plus importants pour transmettre un sentiment de proximité.
Autre levier essentiel : le design biophilique, qui intègre des éléments naturels dans les espaces construits, et s’impose ainsi comme facteur déterminant de bien-être (notamment au travail). Cette approche cherche l’équilibre sensoriel optimal, évitant tant la surcharge que la sous-stimulation.

Lumière et couleurs | La transformation des espaces
La lumière constitue un pilier fondamental de la neuroarchitecture. Tant naturelle qu’artificielle, elle influence directement notre bien-être, régule nos rythmes circadiens et module notre humeur quotidienne. À l’Université de Séville, des chercheurs étudient spécifiquement comment l’éclairage impacte la santé des soignants et des patients, révélant son rôle central dans les environnements de soin.
L’interaction entre lumière et couleurs façonne profondément notre perception spatiale. Les recherches menées à l’UPV ont démontré que les tons froids améliorent les performances cognitives et que l’intensité lumineuse accroît proportionnellement notre niveau d’attention. Dans cette lignée, Andrea de Paiva, créatrice de Neuroau, a conduit une expérience révélatrice dans un immeuble de bureaux à Singapour, testant l’impact de différentes couleurs de lumière sur la productivité et le bien-être des employés.
La gestion de la lumière requiert également une attention particulière pour éviter l’éblouissement et créer des atmosphères harmonieuses.
La Neuroarchitecture en action | Concevoir des espaces inclusifs
La neuroarchitecture révolutionne notre approche des espaces en intégrant la neurodiversité dans leur conception. Comme l’affirme Hajer Atti, architecte et doctorante à l’Institut des sciences cognitives, cette discipline nous autorise à repenser entièrement la ville inclusive, bénéficiant particulièrement aux personnes autistes, sensibles à leur environnement architectural.
L’architecture thérapeutique développée par Daniel Ejnes transforme l’espace en allié thérapeutique pour les patients atteints de troubles neurologiques. Cette approche repose sur la modularité et l’adaptabilité des environnements, permettant d’ajuster les espaces aux différentes sensibilités sensorielles.
Des applications concrètes existent déjà : le programme « Autism at Work » de SAP (société de logiciel) intègre des espaces de travail personnalisables, tandis qu’au Centre Hospitalier Le Vinatier, Lionel Tabaret a conçu des alcôves offrant des refuges sensoriels aux patients. Dans les établissements de santé comme dans les écoles, l’impact de la configuration spatiale sur l’apprentissage est désormais scientifiquement documenté.
Comme le souligne Cristina Vert (OMS), 23 % des décès mondiaux sont liés à l’environnement, révélant l’immense potentiel d’amélioration offert par la neuroarchitecture à travers ses bénéfices mesurables en santé, bien-être et performance cognitive. Une fusion entre sciences neuronales et architecture qui n’est qu’à ses débuts !
Sources :
- https://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/neuroarchitecture-autisme/
- https://www.lemoniteur.fr/article/neuro-architecture-quesaco.2322933
- https://theconversation.com/la-neuro-architecture-ou-comment-faire-de-lespace-de-travail-un-lieu-de-neurodiversite-de-cohesion-sociale-et-dinnovation-231938
- https://www.geo.fr/sciences/neuro-architecture-quand-larchitecture-participe-au-mieux-etre-des-personnes-autistes-218833
Essayez OOTI gratuitement pendant 14 jours















.jpg)











.jpg)














